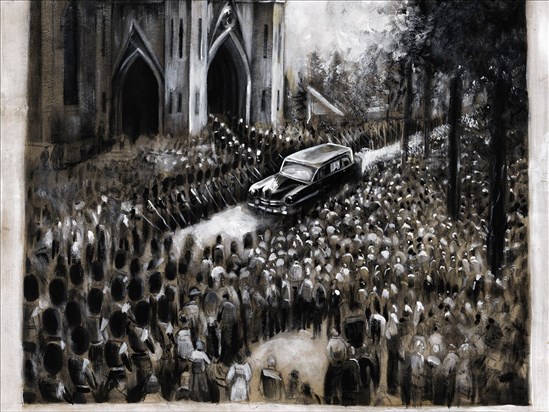Ça s’appelle : Au temps du bois debout. Mémoires de la colonisation au Saguenay–Lac-Saint-Jean (1838-1910). Aux éditions Saguenayensia. C’est un ouvrage qui devrait devenir une lecture obligatoire dans toutes les écoles de notre région. Ce fut mon livre de chevet des dernières semaines, et, à chaque séance de lecture, j’avais l’impression d’embarquer dans une machine à voyager dans le temps.
Loin de moi l’idée de vouloir culpabiliser qui que ce soit, ni de cracher sur les avantages de notre modernité. Je suis de ceux qui croit que notre époque est formidable. Certes pleine de défis, principalement au chapitre de l’environnement, mais aucune époque n’a offert autant de commodités. On a tout au bout des doigts, les voyages sont devenus monnaie courante, nos demeures sont bien chauffées, climatisées, isolées, on a des choix de denrées comme jamais, un système de santé gratuit. Bien sûr notre époque n’est pas parfaite, et plusieurs doivent travailler fort pour arriver à joindre les deux bouts. Mais, avouez, en lisant les multiples complaintes sur les réseaux sociaux, ça donne l’impression que plusieurs de plaignent le ventre plein.
Car rien ne peut être comparé aux mérites de nos premiers bâtisseurs. Des exemples ?
Un colon, sans le sou, raconte son voyage en goélette à partir de Charlevoix. Il accoste à Port Alfred, remonte les rivières jusqu’à Saint-Gédéon (Pas de routes évidemment). On lui donne une parcelle de terre qu’il doit défricher à la hache. Les journées sont épuisantes, il se nourrit de pommes de terre, et de galettes dures faites d’eau et de farine. Mais quelle fierté de semer et de cueillir sa première récolte de blé…
Une mère de famille décrit en détail la fabrication de leur première maison : poutres équarries à la cognée, calfeutrage à la mousse, toit de bardeaux taillés à la main. Elle explique aussi comment on fabriquait un lit, une table et des chaises avec le bois qu’on avait, le tout souvent assemblés sans clou.
Des habitants de Roberval racontent comment ils guidaient, en canot, des riches pêcheurs américains sur les rivières du lac Saint-Jean, qui séjournaient à l’immense Hôtel Roberval, construit en 1888 par Horace Jansen Beemer, et détruit par un incendie en 1908. Ils décrivent l’abondance de ouananiches dans la Grande Décharge. Il y a d’ailleurs plusieurs lignes sur les bateaux qui naviguaient alors sur le lac, et qui transportaient des denrées, de la marchandise et des personnes d’un bout à l’autre du Piékouagami.
Il y a aussi cette histoire d’un homme, également de Roberval, chargé de faire traverser, en « sleigh » tirée par un cheval, un médecin jusqu’à Péribonka, pour y soigner un malade, en pleine tempête de neige sur le lac Saint-Jean. Impossible de se repérer sur le lac. Il fallait se fier à l’instinct de la vieille jument…
Une famille de colons avec enfants arrive désargentée dans le coin de Chambord. Ils sont complètement démunis, pauvres. Le curé de l’endroit les prend en charge et demande à un fermier de leur prêter sa cabane à cochons pour qu’ils s’y installent pour l’hiver.
En voulez-vous d’autres ? Procurez-vous le livre. 300 pages de témoignages de nos fiers bâtisseurs qui vont vous faire oublier vos petits inconforts. En plus d’une belle leçon d’histoire, c’est une remise en perspective de nos priorités, un regard sur l’évolution rapide de notre région comme communauté. Il me semble que nous avons tous un devoir de mémoire, et ce livre est une bonne façon de se rappeler d’où nous venons et surtout à qui nous devons notre niveau de vie.